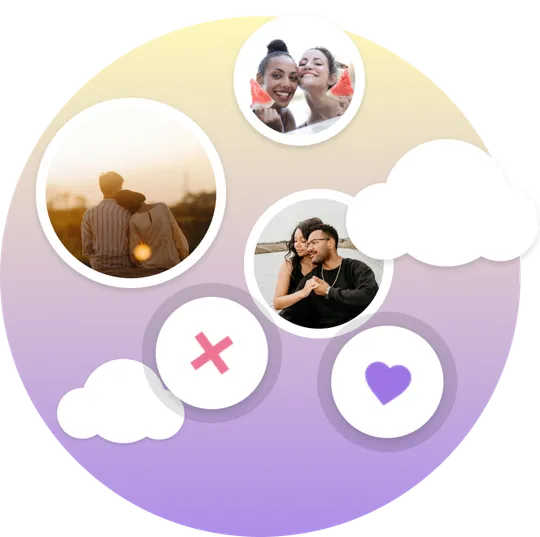Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article
Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.

Cet article vous est offert
Pour lire gratuitement cet article réservé aux abonnés, connectez-vous
Se connecter
Vous n'êtes pas inscrit sur Le Monde ?
Inscrivez-vous gratuitement
Dix ans après la naissance de l’application, Marie Bergström, sociologue spécialiste des rencontres amoureuses en ligne, évoque ce que Tinder a révélé ou transformé dans les pratiques pour établir des relations sexuelles ou amoureuses.
Il y a dix ans, le 12 septembre 2012, est apparu Tinder, révolutionnant le paysage des rencontres en ligne de façon inédite. L’application de rencontres se distinguait de ses concurrents par sa technique de balayage, le fameux « swipe », qui a été amené à simplifier radicalement la sélection des potentiels partenaires amoureux ou sexuels. Un simple mouvement de doigt vers la gauche pour dire non et vers la droite pour dire oui. Si les deux utilisateurs s’accordent, un « match » unique apparaît. En une décennie, grâce à ses innovations audacieuses, Tinder a conquis plus de 50 millions d’utilisateurs à travers le globe et est devenue indéniablement l’une des applications de rencontres les plus téléchargées au monde. Une véritable vedette dans l’univers des applications.
Dans l’Hexagone, son usage et son évolution ont été méticuleusement étudiés par Marie Bergström, sociologue à l’Institut national d’études démographiques (INED), reconnue comme une spécialiste des rencontres amoureuses en ligne. Au cours d’un entretien au Monde, elle évoque en profondeur ce que l’application a révélé ou transformé dans les pratiques pour établir des relations sexuelles ou amoureuses, offrant ainsi un aperçu fascinant sur l’impact de cette plateforme dans nos vies quotidiennes.
Quand les premières plates-formes de rencontre ont fait leur apparition, au début des années 2000, beaucoup des couples qui se croisaient sur Meetic ou Match n’osaient pas l’admettre publiquement. Ils créaient des histoires fictives sur le lieu de leur rencontre, souvent celui du premier rendez-vous. L’usage de ces plates-formes était perçu négativement par la société, et les utilisateurs étaient souvent qualifiés de désespérés, de pervers, de nymphomanes ou encore de « losers ». L’image stigmatisante attachée à ces rencontres en ligne est aujourd’hui moins marquée, même si elle persiste encore de façon diffuse. On ne peut plus dire qu’il y ait un tabou profond, et Tinder a joué un rôle essentiel dans ce changement culturel. Le stigmate a effectivement disparu, mais il n’a pas été remplacé par une image largement positive de la rencontre en ligne.
Désormais, la majorité des individus assument sans hésitation avoir rencontré quelqu’un par l’intermédiaire d’une application. Toutefois, cette méthode ne suscite pas encore un jugement unanimement romantique. Nombreux sont ceux qui expriment un sentiment de désillusion en déclarant : « J’aurais aimé qu’il en soit autrement. » Le changement majeur dans la perception de cette pratique est étroitement lié à la démocratisation et à la vulgarisation de l’usage, qui s’est répandu parmi un large éventail d’utilisateurs. La technologie et l’interface des applications telles que Tinder, associées à notre époque moderne, ont considérablement facilité cette transition.
Aux États-Unis et en Allemagne, des recherches menées en 2019 et 2020 ont révélé que les sites et applications de rencontre sont devenus le troisième lieu de rencontre le plus fréquenté, juste après les interactions via les amis ou la famille et celles réalisées sur le lieu de travail ou d’étude. Ces plates-formes en ligne ont réussi à détrôner d’autres espaces de sociabilité, tels que les bars, les associations ou même l’espace public traditionnel.
L’application a mis à nu les mécanismes de sélection et d’élimination qui s’opèrent dans l’appariement des partenaires, révélant ainsi les véritables dynamiques du choix amoureux ou sexuel. Ces mécanismes ne sont pas spécifiques à Tinder ou à d’autres applications similaires. Dans le cadre d’une soirée, les participants défilent sous nos yeux, et, inconsciemment, nous sommes amenés à les juger sur des critères tels que l’apparence physique, la posture ou encore le style vestimentaire. Tous ces éléments influencent notre estimation, déterminant s’ils sont intéressants ou correspondent à nos idéaux. La mécanique opérante sur Tinder est semblable, mais ce qui diffère, c’est d’une part la masse de personnes à laquelle nous sommes exposés et d’autre part le fait d’être confrontés à tout ce que nous allons directement rejeter. Nous devenons ainsi plus conscients de notre jugement.
Dans la vie hors ligne, la sélection se fait de manière plus feutrée, moins visible. Tinder, en revanche, rend l’élimination non seulement perceptible mais aussi tangible, tendant un miroir à nos comportements, ce qui peut parfois déranger. Ce phénomène ne s’accorde pas avec les belles histoires romantiques que l’on a l’habitude d’entendre, ni avec une certaine vision idéalisée de l’amour. Les biais racistes et le sexisme dont l’application a été accusée ne sont pas uniquement propres à Tinder, mais s’inscrivent dans un cadre de pratiques sociales plus large. L’algorithme joue incontestablement un rôle, puisqu’il est conçu pour privilégier certains profils plutôt que d’autres, mais l’appariement final – qui « matche » avec qui – repose essentiellement sur les comportements des utilisateurs. Il existe certes un cadre technique, mais celui-ci est souvent surestimé par rapport à l’équation plus vaste où les choix individuels jouent un rôle prépondérant. Face à une image parfois peu flatteuse que ces plates-formes peuvent nous renvoyer, il est plus facile d’imputer la responsabilité au médium plutôt que de se pencher sur nos propres comportements.
La métaphore de la consommation exprime une critique forte et efficace, mais elle ne reflète pas fidèlement la nature de l’application et de ses pratiques. Les utilisateurs ne se comportent pas de manière consumériste, et il est inexact de dire qu’ils interagissent sur Tinder de la même façon qu'ils le feraient dans un supermarché. Quand une personne évalue un potentiel partenaire, elle ne le fait pas sur le même critère qu'un produit de consommation. Cette vision simpliste empêche d’appréhender la véritable nouveauté introduite par ces plates-formes.
Newsletter
« Pixels »
Réseaux sociaux, cyberattaques, jeux vidéo, mangas et culture geek
S'inscrire
De mon point de vue, le vrai changement réside ailleurs. Outre Tinder, les sites et applications de rencontres ont inauguré un espace exclusivement consacré à la rencontre amoureuse. Avant l’émergence de ces plates-formes, les rencontres amoureuses et sexuelles se déroulaient habituellement dans des lieux de sociabilité traditionnels, tels que la sphère professionnelle ou familiale. Historiquement, pour la population hétérosexuelle, il n’existait aucun lieu spécifiquement désigné pour les rencontres.
Cela explique en partie la réussite éclatante de Tinder et de ces plates-formes de rencontres. L’attrait de ces applications réside dans la possibilité de dissocier les rencontres intimes de son cercle social. De plus, les utilisateurs peuvent s’engager et se désengager beaucoup plus facilement. Les conséquences de leurs actes sont moins réfléchies, car l’entourage n’est pas impliqué dans leurs choix et n’a aucun contrôle. Et puis, s’il y a un faux pas, les chances de se recroiser sont minimes, ce qui peut également favoriser des comportements déplacés, comme la violence ou le harcèlement. Les personnes impliquées dans ces actes ont moins de comptes à rendre, contrairement à ce qui pourrait se produire dans un cadre de sociabilité conventionnel où tout est susceptible d’être su par l’entourage.
Les relations évoluent aussi plus rapidement sur ces plates-formes, car le processus de rapprochement est considérablement accéléré. Lorsque l’on obtient un « match » sur Tinder, cela rend explicite l’attirance réciproque, laissant peu de place au doute. Ainsi, le temps écoulé entre le premier contact et le premier rapport sexuel est généralement beaucoup plus réduit que dans le cas d’une rencontre au cours d’une soirée entre amis.
Tout dépend de la mesure que l’on prend en compte, car le simple fait d’être téléchargé ne signifie pas nécessairement qu’il soit utilisé. Dans le monde occidental, Tinder constitue un acteur très significatif du marché, mais d'autres services existent en Inde, en Chine ou en Amérique du Sud, par exemple. On sait que les plates-formes de rencontres se adaptent aux codes culturels de chaque région, et en Inde, il n'est pas rare de voir des parents créer des profils pour leurs enfants.
De plus, le secteur économique des plates-formes de rencontres tend à prendre une tournure monopolistique, avec les grandes entreprises rachetant les plus petites – un phénomène qui n’est pas propre à l’univers numérique. Le site de rencontre Match a acquis Tinder et Meetic, qui à son tour a racheté de plus petites applications. La majorité de ces plates-formes supposément concurrentes appartiennent en réalité à un seul conglomérat américain, InterActiveCorp.
Parallèlement, avec le temps, certaines plates-formes ont vu leur population changer et notamment vieillir. La démographie de Meetic, qui fête ses vingt ans, a effectivement évolué. Il est aisé de prédire que Tinder, dans dix ans, pourrait devenir une application ringardisée aux yeux des jeunes de demain, même s’il tente de s’adapter et d’innover pour rester pertinent.
Souvent, ce sont des personnes jeunes, socialement favorisées et ayant bénéficié d'un parcours d’enseignement supérieur qui ont pris la tête de ces nouvelles technologies « à la mode », avant que les plates-formes ne se démocratisent et ne deviennent plus mixtes. Au départ, Tinder a vu le jour dans les cercles des grandes écoles américaines. Aujourd’hui, sa population est devenue plus variée, incluant des utilisateurs plus âgés ou issus de milieux sociaux moins favorisés.
Parmi les premiers utilisateurs, certains jeunes ont fini par quitter l’application pour échapper à cette diversification et retrouver le milieu homogène des débuts, qui favorisait l’homogamie. Ce phénomène est également observable sur d’autres plates-formes : de nombreux utilisateurs, initialement très éduqués, se sont ensuite redirigés vers des plates-formes plus onéreuses et exclusives, restreintes par affinités ou spécialisées. Des applications comme Bumble, par exemple, se sont orientées dans ce sens. Les questions posées par l’application y sont plus développées, s’intéressant davantage à la situation socio-économique des utilisateurs. Cette recherche d’entre-soi est très forte, mais rarement admise, ni par les utilisateurs ni par les entreprises.
Fatoumata Sillah
Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois
Ce message s’affichera sur l’autre appareil.
Découvrir les offres multicomptesParce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil.
Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la fois (ordinateur, téléphone ou tablette).
Comment ne plus voir ce message ?
En cliquant sur « » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consulter Le Monde avec ce compte.
Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?
Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connecté avec ce compte.
Y a-t-il d’autres limites ?
Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant à des moments différents.
Vous ignorez qui est l’autre personne ?
Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
Lecture restreinte
Votre abonnement n’autorise pas la lecture de cet article
Pour plus d’informations, merci de contacter notre service commercial.