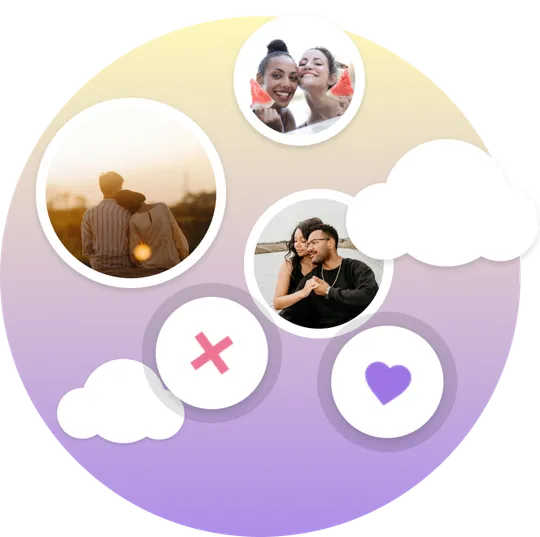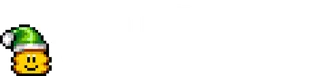Publié par Quai des Savoirs, le 3 mai 2021 2.3k
Rencontre avec Marie Bergström, sociologue du couple et de la sexualité, chargée de recherche à l’Institut national d’études démographiques (INED), dans le cadre de l'exposition De l'amour présentée au Quai des Savoirs jusqu'au 7 novembre 2021.
Crédit : Alexander Sinn | Unsplash
Vous avez étudié les traces numériques que nous laissons sur les sites et applications de rencontres. Qui les utilise ? Y a-t-il une distorsion entre ce que nous leur confions et la réalité ?
Dans le cadre de mes recherches approfondies, j'ai pu examiner les traces numériques que laissent les utilisateurs sur les différentes plateformes de rencontres. Ces interactions révèlent beaucoup sur la façon dont les usagers se présentent et interagissent avec les autres. Il est important de souligner que toutes les données recueillies sont strictement anonymes afin de protéger l'identité des individus. En aucun cas, il n'a été possible d'identifier un individu spécifique ou d'accéder à ses échanges. Mes études démontrent que les services de rencontres ont connu un succès fulgurant et que leur utilisation s'est largement démocratisée au fil du temps. Autrement dit, les usagers sont devenus de plus en plus diversifiés sur le plan géographique, social et en termes d'âge. Contrairement à une idée fausse largement répandue, les profils des utilisateurs sont généralement représentatifs de la réalité. Bien sûr, chacun a tendance à se présenter sous son meilleur jour, comme dans toute situation de séduction, mais les mensonges extrêmes demeurent statistiquement rares.
En quoi les sites de rencontres ont-ils modifié nos comportements amoureux ?
Le changement le plus marquant est ce que je nomme une « privatisation » de la rencontre amoureuse. Historiquement, les rencontres amoureuses et sexuelles se sont toujours déroulées dans des espaces de sociabilité tels que les lieux de sortie, les loisirs, les études ou le travail. Jamais auparavant, il n'existait d'espace spécifiquement dédié à la rencontre romantique. Cela a radicalement changé avec l'émergence de services spécialisés. Grâce à des sites et des applications dédiés, il est devenu évident que les interactions de nature intime se déroulent désormais en dehors des contextes sociaux habituels, et souvent à l'insu des cercles sociaux, ce qui confère à ce processus un caractère beaucoup plus discret. Ce phénomène, que je décris comme une forme d’« privatisation », a profondément modifié la manière dont nous interagissons dans le domaine des relations amoureuses.
Que disent-ils sur la formation des couples au 21e siècle ?
Le succès de ces services de rencontres peut s'expliquer en grande partie par la complexité croissante des parcours conjugaux que nous avons observés au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, les individus ont tendance à s'engager dans une relation amoureuse plus tard dans la vie, ce qui implique qu'ils passent plus de temps célibataires durant leur jeunesse. Nous observons également une augmentation des séparations, entraînant le fait que beaucoup vivent « hors couple » à un âge plus avancé. Ces services de rencontres reflètent donc cette évolution des trajectoires de vie, où le célibat devient de plus en plus fréquent. Il est crucial de noter que ces changements n'indiquent pas un affaiblissement du désir de nouer des liens amoureux solides et durables. Avec mes collègues Françoise Courtel et Géraldine Vivier, nous avons démontré qu’au contraire, la norme de vivre en couple est peut-être plus forte que jamais*.
Y a-t-il une inégalité entre les femmes et les hommes face à la rencontre (âge, comportement amoureux…) ?
Il existe effectivement des disparités entre les femmes et les hommes concernant le célibat, qui varient selon les tranches d'âge, et cela est principalement dû aux préférences en matière d'âge des partenaires. Pour commencer, les jeunes femmes ont tendance à rechercher des partenaires légèrement plus âgés, tandis que les jeunes hommes éprouvent davantage de difficultés à faire des rencontres. De plus, les hommes qui se sont séparés cherchent souvent des partenaires plus jeunes que eux, alors que les femmes qui ont divorcé ou qui se sont séparées se remettent moins fréquemment en couple que leurs homologues masculins. Ces différences, qui sont en grande partie liées à la « démographie du célibat », sont bien documentées et persistent à notre époque. Elles ne sont pas spécifiques à l'ère du numérique.
Faire dépendre une rencontre d'un algorithme, n'est-ce pas un peu frustrant ? Et le hasard dans tout ça ?
Pour commencer, l'idée selon laquelle le hasard serait au cœur des rencontres est un mythe. Les sociologues ont depuis longtemps démontré que les personnes qui se ressemblent tendent à se rassembler. Cela est vrai tant dans les interactions en ligne qu'hors ligne. De plus, il faut préciser que les rencontres en ligne ne reposent pas uniquement sur un algorithme. Bien que les plateformes facilitent la rencontre en présentant certains utilisateurs aux autres, les choix finaux reviennent aux usagers eux-mêmes. En fonction de leurs préférences personnelles, ils décident de contacter une personne plutôt qu'une autre. Je pense que la focalisation excessive sur les algorithmes en fait des boucs-émissaires : cela nous empêche de comprendre que, si les couples ne se forment pas par le pur hasard, c'est avant tout grâce à nos goûts et désirs personnels qui ont guidé ces choix.
* Bergström, Courtel & Vivier (2019), La vie hors couple, une vie hors norme ? Expériences du célibat dans la France contemporaine, Population, vol. 74, n° 1, p. 103-130
Pour aller + loin :
- Podcast "Détour vers le futur" #1 : "Coup de foudre en ligne ?
- Interviews enrichissantes sur les relations modernes
- Découvrez notre exposition sur l'amour
- Approfondissez votre compréhension de l'amour